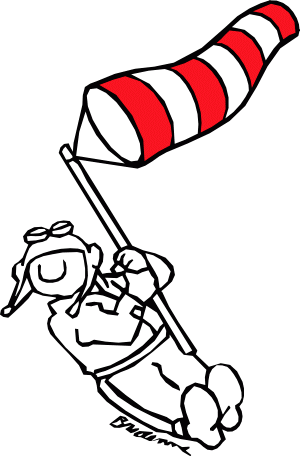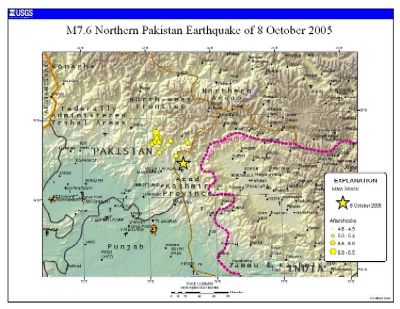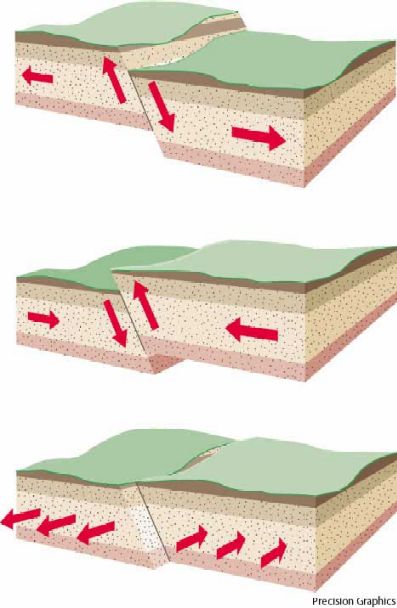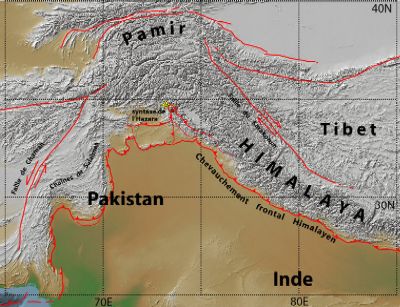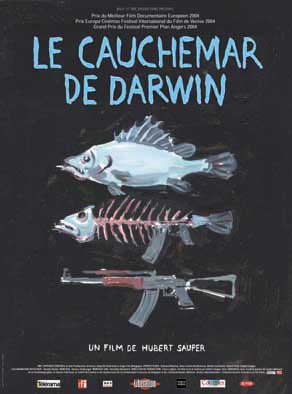Wangari Muta Maathai (née le 1er avril 1940 à Nyeri, au Kenya) est une militante écologiste et politique. En 2004, elle devient la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix pour « sa contribution en faveur du développement durable, de la démocratie et de la paix ».
Source :
Wikipedia
Propos recueillis par Ethirajan Anbarasan, journaliste au Courrier de l’UNESCO.
Cette grande figure de la lutte pour la protection de l’environnement, pour la démocratie et pour les droits des femmes espère qu’une nouvelle génération de dirigeants africains donnera la priorité aux besoins du peuple.
Il est impossible, à vos yeux, d’améliorer la qualité de l’environnement tant que les conditions de vie de la population n’auront pas elles-mêmes été améliorées. Pourquoi ?
Si nous voulons sauvegarder la nature, commençons par protéger les êtres humains: ils font partie de la biodiversité. Si nous ne pouvons pas préserver notre propre espèce, à quoi rime de sauver les espèces d’arbres ? On a parfois l’impression que les pauvres détruisent la nature. Mais ils sont si préoccupés par leur survie qu’ils ne peuvent pas s’inquiéter des dégâts durables qu’ils infligent à l’environnement. Donc, paradoxalement, les pauvres, qui dépendent de la nature, sont aussi en partie responsables de sa destruction. Voilà pourquoi je répète que nous devons améliorer leurs conditions de vie si nous voulons réellement sauver notre environnement.
Ainsi, dans certaines régions du Kenya, les femmes font des kilomètres à pied pour aller chercher du bois de chauffe en forêt: près de chez elles, il n’y a plus d’arbres; elles doivent aller toujours plus loin pour en trouver. Comme le bois est rare, les repas cuits sont moins nombreux, l’alimentation en pâtit, la faim gagne du terrain. Si ces femmes étaient moins pauvres, elles n’iraient pas dégrader une précieuse forêt.
Quels sont les enjeux actuels pour les forêts du Kenya et d’Afrique orientale ?
Depuis le début du siècle, la tendance est claire: on abat des forêts primaires et on replante des espèces exotiques commercialisables. Nous en mesurons mieux les conséquences aujourd’hui. Nous avons compris qu’il ne fallait pas abattre les forêts locales, afin de préserver notre riche biodiversité. Mais déjà, les dégâts sont importants. En 1977, quand notre mouvement Ceinture verte (voir encadré) a commencé sa campagne de plantation d’arbres, le couvert forestier du Kenya était d’environ 2,9%. Aujourd’hui, il est de 2%. Nous perdons plus d’arbres que nous n’en plantons.
Autre gros problème: l’environnement de l’Afrique orientale est très vulnérable. Nous sommes proches du Sahara et, selon les experts, le désert pourrait s’étendre vers le sud comme un fleuve en crue, si nous continuons à abattre des arbres sans discernement: ce sont eux qui empêchent l’érosion des sols par la pluie et le vent. En défrichant les bouts de forêt qui nous restent, nous créons en fait quantité de micro-Sahara. Nous en voyons déjà les isgnesen voir des preuves.
Notre mouvement organise des séminaires d’éducation pour les ruraux, en particulier les cultivateurs, dans le cadre de campagnes de sensibilisation sur les questions d’environnement. Si l’on demande à 100 agriculteurs combien parmi eux se souviennent d’une source ou d’un cours d’eau qui s’est tari de leur vivant, près de 30 lèvent la main.
Quelles sont les réalisations du mouvement Ceinture verte? Dans quelle mesure a-t-il empêché la dégradation de l’environnement au Kenya ?
Son plus grand succès, à mes yeux, a été d’éveiller les citoyens ordinaires, en particulier les ruraux, aux problèmes écologiques. Les gens ont compris que l’environnement est l’affaire de tous et pas seulement du gouvernement. C’est en partie grâce à cette prise de conscience que nous avons désormais l’oreille des responsables politiques: les citoyens les mettent au défi de protéger la nature.
Ceinture verte a aussi promu l’idée de préserver l’environnement par les arbres, qui satisfont beaucoup de besoins essentiels dans les communautés rurales. A nos débuts, en 1977, nous avons planté sept arbres dans un petit parc de Nairobi. A cette époque, nous n’avions ni pépinières, ni équipes, ni argent mais une conviction: les gens ordinaires des campagnes ont leur rôle à jouer pour résoudre les problèmes écologiques. Aujourd’hui, nous avons planté plus de 20 millions d’arbres dans tout le Kenya. Cet acte est porteur d’un message simple: tout citoyen peut au moins planter un arbre pour améliorer son cadre de vie. Chacun réalise ainsi qu’il peut prendre en charge son environnement, premier pas vers une participation plus active au sein de la société. Comme les arbres que nous avons plantés sont bien visibles, ils sont les meilleurs ambassadeurs de notre mouvement.
Malgré le sommet de la Terre de Rio en 1992 et le protocole de Kyoto sur le climat signé en 1997, les programmes et les campagnes de protection de l’environnement au niveau mondial n’avancent pratiquement pas. Pourquoi ?
Pour beaucoup de dirigeants de la planète, le développement continue malheureusement de signifier culture extensive de denrées agricoles exportables, barrages hydroélectriques ruineux, hôtels, supermarchés et produits de luxe, qui contribuent au pillage des ressources naturelles. C’est une politique à courte vue qui ne répond pas aux besoins essentiels des gens: une alimentation suffisante, de l’eau potable, un toit, des hôpitaux de proximité, de l’information et la liberté. Cette frénésie de prétendu «développement» a relégué la protection de l’environnement à l’arrière-plan. Le problème, c’est que ceux qui portent une lourde responsabilité dans la destruction de l’environnement sont précisément ceux qui devraient soutenir des campagnes écologiques. Ils ne le font pas. Les détenteurs du pouvoir politique font des affaires et entretiennent des liens étroits avec les multinationales. Et celles-ci n’ont d’autre but que de gagner de l’argent aux dépens de l’environnement et de la population.
Nous savons que les multinationales persuadent de nombreux dirigeants politiques de ne pas prendre au sérieux les conférences internationales sur l’environnement. Je suis fermement convaincue que nous devons refuser, en tant que citoyens, d’être à la merci de ces sociétés. Elles peuvent être absolument impitoyables: elles sont sans visage humain.
Vous avez d’abord été universitaire, puis écologiste. Aujourd’hui, vous vous définissez comme une militante en faveur de la démocratie. Comment analysez-vous cette évolution ?
Rares sont aujourd’hui les écologistes qui se soucient exclusivement du bien-être des abeilles, des arbres et des papillons. Ils savent qu’il est impossible de préserver l’environnement si le gouvernement ne contrôle pas les industries polluantes et le déboisement. Au Kenya, des promoteurs immobiliers ont été autorisés à construire de coûteuses résidences au cœur des forêts primaires. Il est de notre devoir, en tant qu’individus responsables, de nous y opposer. Mais dès qu’on intervient dans ce type d’affaires, on se trouve en conflit direct avec des responsables politiques et on se fait traiter d’agitateur.
Dans les années 70, j’ai d’abord enseigné à l’Université de Nairobi. J’ai alors eu le sentiment que les droits des enseignantes au sein de l’université n’étaient pas respectés parce qu’elles étaient des femmes. J’ai donc milité pour revendiquer ces droits. Parallèlement, je me suis trouvée confrontée à d’autres problèmes comme les droits de l’homme, qui étaient étroitement liés à mon travail mais qui n’étaient pas clairs pour moi, au début. Cela m’a conduit à aborder les questions de gouvernance.
J’ai compris, au cours de ces années 70 que, dans une jeune démocratie comme la nôtre, il était très facile pour des gouvernants de devenir dictateurs, puis d’utiliser les ressources nationales comme leur propriété privée: la Constitution leur donnait le pouvoir de faire mauvais usage de l’appareil d’Etat. Je me suis donc engagée dans le mouvement pour la démocratie. J’ai réclamé des réformes constitutionnelles et un espace politique pour assurer les libertés de pensée et d’expression. Nous ne pouvons pas vivre sous un régime qui tue la créativité et encourage la lâcheté.
Avec vos diplômes, vous auriez pu vivre confortablement en Occident. Vous avez préféré regagner le Kenya. Or, pendant 25 ans, on vous a abreuvée d’injures, menacée, battue, jetée en prison et interdit à plusieurs reprises de quitter le territoire. Avez-vous jamais regretté d’être rentrée au pays et d’y militer ?
Devenir militante n’a pas été une décision délibérée. Mais je n’ai jamais regretté d’être restée ici, pour contribuer au développement de mon pays et de ma région. Je sais que j’ai fait un petit quelque chose. De nombreuses personnes viennent me voir et me disent que mon travail les a inspirées. Cela me réjouit parce qu’au début, en particulier pendant la dictature, il était difficile de parler. Il y a encore quelques années, des passants m’approchaient dans la rue et chuchotaient: «Je suis avec vous; je prie pour vous.» Ils ne voulaient pas qu’on les entende. Beaucoup avaient peur de me parler et d’être vus avec moi car ils risquaient d’être sanctionnés.
J’ai eu plus d’impact en subissant des procès et autres tribulations que si j’étais partie à l’étranger, si j’avais dit, en vivant en Occident: «Mon pays devrait faire ceci ou cela.» Sur place, j’encourage beaucoup plus de gens.
Avez-vous été en butte à tant d’attaques virulentes et d’exactions parce que vous contestiez des décisions prises par des hommes ?
Nos hommes pensent que les Africaines doivent être dépendantes et soumises — et surtout pas meilleures que leur mari. Au début, beaucoup de gens étaient effectivement contre moi parce que je suis une femme: ils ne supportaient pas que j’aie des opinions tranchées. Je sais qu’à certains moments, des hommes haut placés, dont le président Daniel Arap Moi, m’ont tournée en dérision. Un jour, des parlementaires railleurs m’ont reproché d’être divorcée. Au fond d’eux-mêmes, ils espéraient qu’en mettant en cause ma féminité, ils allaient me faire taire. Ils ont compris plus tard qu’ils s’étaient trompés.
En 1989 par exemple, nous avons eu un grave affrontement avec les autorités: nous nous sommes battus pour sauver le parc Uhuru de Nairobi. Je soutenais qu’il était absurde de supprimer ce parc magnifique, en plein centre-ville, pour construire des immeubles. C’était le seul endroit de Nairobi où les citadins pouvaient passer un moment en plein air avec leur famille, sans être importunés. Quand j’ai lancé la campagne contre la construction du «monstre du parc», surnom du projet immobilier, on m’a ridiculisée, on m’a accusée de ne rien comprendre au développement. Je n’ai pas étudié cette discipline mais je sais que, dans une ville, on a besoin d’espace. Heureusement, d’autres ONG et des milliers de citoyens se sont joints à nous et le parc a finalement été sauvé. Le gouvernement qui voulait le détruire l’a depuis déclaré patrimoine national. Merveilleux. Ils auraient pu le faire en évitant violences et moqueries à mon encontre.
Pourquoi vous êtes-vous présentée aux présidentielles de 1997 ? Et pourquoi, malgré votre popularité, n’avez-vous pas recueilli un nombre important de suffrages ?
En 1992, quand le multipartisme a été légalisé au Kenya, j’avais fait de gros efforts, avec d’autres groupes politiques, pour unir l’opposition. En vain. Je me suis alors retirée parce trop de candidats d’opposition étaient en lice pour la présidence. Comme il était prévisible, l’opposition a perdu, et tout le monde admet aujourd’hui dans ses rangs que la campagne que nous avions lancée pour l’union était une bonne idée. Nous voulions former une sorte d’unité nationale au sein de l’opposition dès 1992. Exactement ce qu’elle prône aujourd’hui.
Pour les élections de 1997, j’ai cherché à persuader l’opposition de s’unir afin de présenter contre la KANU1, parti dominant au Kenya, un candidat fort issu d’une des communautés ethniques. Mais certaines de ses composantes m’ont traitée de «tribaliste» pour avoir émis cette idée. Devant l’échec de tous mes efforts unitaires, j’ai décidé de me présenter seule. Pendant la campagne, je me suis aperçue que, dans ce pays, il est très difficile de se faire élire sans argent. Je n’avais pas d’argent. J’ai compris que la valeur, l’honnêteté, les sentiments démocratiques importaient peu, si l’on n’a pas d’argent à donner aux électeurs. Alors, j’ai perdu.
J’ai aussi constaté que la population n’est pas encore prête pour la démocratie, qu’il nous faudra beaucoup d’éducation civique et de prise de conscience politique. On reste dominé par l’ethnie, on vote en fonction de clivages ethniques. Cette question est d’ailleurs devenue un enjeu majeur lors des dernières élections.
Malgré ses immenses ressources naturelles, l’Afrique est le continent à la traîne du développement et de la croissance. Pourquoi ?
Parce qu’elle est mal gouvernée, c’est évident. Ses dirigeants passeront dans l’histoire comme une génération d’irresponsables, qui ont mis leur continent à genoux. Durant les 30 dernières années, l’Afrique a manqué de gouvernants altruistes et visionnaires, soucieux du bien-être du peuple.
Il y a des raisons historiques à cela. Juste avant d’octroyer l’indépendance à de nombreux pays africains, les colons ont promu de jeunes Africains à des postes jusque-là inaccessibles aux indigènes, ils les ont formés pour prendre le relais. Ces nouveaux administrateurs, ces élites noires naissantes, ont joui du même mode de vie, des mêmes privilèges économiques et sociaux que les hauts fonctionnaires des empires coloniaux. Et, sur le plan des objectifs pour le pays, rien ne distinguait les nouveaux dirigeants des anciens, sauf la couleur de la peau. C’est ainsi que les gouvernants africains ont abandonné leur peuple. Pour conserver le pouvoir, ils ont suivi exactement la recette du colonialisme: dresser une communauté contre une autre. Ces conflits ont duré des décennies dans quantité de pays, drainant leurs maigres ressources. Donc, nous devons améliorer notre gouvernance. Sinon, il n’y a pas d’espoir. Si notre peuple est incapable de se protéger lui-même, il continuera à être exploité, et ses ressources également. Par ailleurs, les puissances occidentales, notamment les anciens maîtres coloniaux, ont continué à exploiter l’Afrique et à coopérer très étroitement avec ces dictateurs et ces dirigeants irresponsables.
Voilà pourquoi nous sommes si accablés de dettes, impossibles à rembourser. L’Afrique a besoin d’une aide internationale pour améliorer sa position économique. Or, l’aide étrangère qu’elle reçoit relève surtout de l’assistance thérapeutique: secours d’urgence contre la famine, aide alimentaire, contrôle des naissances, camps de réfugiés, forces de maintien de la paix, missions humanitaires. Il n’y a pratiquement pas d’argent pour le développement humain durable: éducation et formation, développement des infrastructures, production alimentaire, aide à la création d’entreprises. Il n’y a pas un sou pour les initiatives culturelles et sociales qui donneraient aux individus une certaine prise sur leur vie et libéreraient leur énergie créatrice.
J’espère qu’au cours du prochain millénaire, de nouveaux dirigeants apparaîtront en Afrique, qu’ils penseront davantage à leur peuple et se serviront des ressources du continent pour aider les Africains à sortir de la pauvreté.
Source : UNESCO
Autre page intéressante sur le prix Nobel de la Paix 2004 : Afrik.com